L
O
K
A
comme Louanj
comme O
comme Ka
comme Aw
LOKA, C'EST QUOI ?
Le projet LOKA est une initiative ethnodoxologique : exprimer sa foi et entendre les merveilles de Dieu dans son « authenticité » culturelle, et plus particulièrement, artistique ; et ce, afin de permettre au chrétien de la Guadeloupe une interaction avec l’Évangile non seulement cognitive mais viscérale. L’objectif : l’édification et la croissance de la foi (1 Cor 14).
Le projet LOKA c’est œuvrer auprès des communautés protestantes évangéliques locales pour les accompagner dans une démarche d’actualisation liturgique : passer de l’aliénation à la contextualisation (authenticité culturelle), du mimétisme occidental à la créativité (créole), d’une louange désincarnée à une louange in-carnée.
Le projet LOKA ce sont des bik-a-pawol de réflexion sur la société créole, sur les arts traditionnels (le gwoka, le chant bèlè guadeloupéen, le conte, etc.), de dialogue entre artistes, responsables d’église et présidents de culte. C’est aussi l’occasion pour des paroliers (débutants ou expérimentés) et des praticiens du Gwoka (tanbouyé et chantè) de collaborer pour dire et louer Dieu dans son lieu culturel, dans sa langue maternelle, dans sa tradition musicale.
En créant ce site nous souhaitons mettre en commun les atouts poétiques et musicaux des chrétiens et encourager la production d’un répertoire de textes liturgiques (poèmes, chants, récits) composés par les chrétiens de la Guadeloupe et destinés à une louange au son du Ka ou tout au moins dans des formes musicales et poétiques traditionnelles.

(École de théologie du Québec)
Professeure associée à l'Université Laval (ETEQ)
mon histoire
Je suis Ruth Labeth née à Paris (France) de parents guadeloupéens. J’ai étudié la musicologie à l’Université Bloch de Strasbourg et j’ai poursuivi des études en théologie au Toronto Baptist Seminary (Canada) et à la Faculté Jean Calvin d’Aix-en-Provence. Par la suite, j’ai œuvré en Martinique comme assistante paroissiale dans divers ministères (catéchèse, jeunesse, chorales…). J’ai ensuite enseigné au Toronto Baptist Seminary (Canada) et travaillé en tant que bibliothécaire et comme chargé de cours à la Faculté de théologie évangélique à Vaux-sur-Seine. Aujourd’hui, j’enseigne des cours de théologie pratique à l’École de théologie évangélique (ETEQ) qui est affiliée à la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l’Université Laval (Canada). Ces expériences à la fois professionnelles et culturelles m’ont conduite à réfléchir sur la place de la culture environnante dans le culte et plus spécifiquement dans l’espace musical. Je m’intéresse pour le moment aux cultures créoles, comme celle de la Guadeloupe.
Quelle place est faite aux genres musicaux traditionnels de la culture locale dans le culte évangélique ?
De 2009 à 2013, je me suis rendue en Guadeloupe pour comprendre les enjeux et les défis d’une valorisation de la culture créole (langue, expression, imaginaire…) dans le culte. Cette recherche a abouti à une thèse de doctorat en 2014 et publiée en 2016 (ANRT) sous le titre : « La musique dans le culte évangélique en terrain créole : une lecture antropo-théologique des pratiques musicales de l’Église évangélique de la Guadeloupe ». Pour commander la thèse se rendre sur : http://www.diffusiontheses.fr/69571-these-de-labeth–ruth.html
le projet loka
POURQUOI LE GWO-KA ?
Tous les peuples possèdent des arts, des traditions artistiques pour s’exprimer et communiquer dans une esthétique marquée inévitablement par l’histoire et qui met en avant les spécificités culturelles.

Le gwoka, musique typique de la Guadeloupe, est un marqueur identitaire de la société guadeloupéenne.
Le gwoka relie (au moins musicalement) le Guadeloupéen à l’Afrique. La présence des percussions, la polyrythmie, le style responsorial des chants, l’improvisation, et l’utilisation du tambour pour exprimer des sentiments sont en continuité avec les pratiques musicales de l’esclave venu d’Afrique. Le gwoka est une manière « d’être en relation » et « d’être au monde » : ne pas perdre pied, rester debout, en titubant, en trébuchant, mais debout. Il est, pour l’esclave, un exutoire, un temps pendant lequel la parole et le corps se libèrent de cette douleur refoulée.
« Quand j’entends le tambour, je tressaille. Le tambour c’est la joie, mais la joie dans la souffrance. Le son du tambour résonne avec ce qu’il y a de plus profond chez le Guadeloupéen : son âme. » (Liliane Tilby, 2023)
« L’esclave dépossédé de son droit à l’humanité reprenait figure humaine à ses propres yeux en martelant sur le tambour… à la fois sa détresse et son espérance, à la fois son besoin irrépressible de révolte et l’appel à des dieux vaincus. La musique pour tout dire était le premier espace de liberté qu’il dérobait au maître, le premier marronnage, le premier vagissement historique de l’homme guadeloupéen. » (Jean Girard, 2008)
Le gwoka est une musique qui parle de résilience, de résistance, de revendication, de reconnaissance. Il est, dit-on, l’âme de la Guadeloupe. Si pendant longtemps, il a été considéré comme une musique « vulgaire » (en comparaison avec des musiques plus occidentales), il est maintenant un élément emblématique de l’identité guadeloupéenne. Il est un espace de reconstruction identitaire, d’acceptation de soi et de libération.
Pourquoi le gwoka ? Parce qu’il y a dans le gwoka plus qu’une musique, il y a une langue, une histoire, une profondeur de l’âme. Le gwoka est un dire dans une langue, le créole, qui est d’ici et non d’ailleurs, et qui a des mots, des expressions qui lui sont propres pour décrire le local.
Dans l’espace du culte, le son du ka et ses éléments constitutifs peuvent permettre au chrétien :
- de mettre en avant son identité créole (et pas seulement européenne)
- de diversifier l’esthétique et la musicalité de ses chants et prières (embellissement du culte)
- d’encourager une expression de l’émotion qui passe autant par la voix que par la gestuelle
- de s’impliquer avec plus d’authenticité et de liberté : se donner le droit d’être créole pour célébrer son Dieu et exprimer sa foi de toute sa pensée, de toute sa force, de son être.
Crédit photographique : @Laurent de Bompuis – site de l’Unesco – Patrimoine culturel immatériel
L’ETHNODOXOLOGIE
Le projet LOKA s’inscrit dans le cadre des approches de contextualisation de la foi chrétienne : tenir compte des réalités culturelles du lieu.

C’est dans ce contexte qu’est née l’ethnodoxologie (ethnos=peuple, doxa=louange), une pratique qui cherche à valoriser la musique traditionnelle et autres arts locaux des peuples missionnés dans le but de faire entendre la louange de toutes les nations (et pas seulement celle de l’Occident) dans leur langue maternelle (heart language) avec des expressions artistiques qui leur sont propres.
« Nous avons soif de voir, dans toutes les cultures, l’Église s’engager énergiquement dans les arts comme contexte pour la mission, en respectant les différences culturelles et célébrant les expressions artistiques autochtones. » (Article 5. La vérité et les arts dans la mission, Engagement du Cap, CLEM 2010).
Cette notion de « langue du cœur » est primordiale pour l‘ethnodoxologie, tant il est vrai « que le langage est la maison de l’être » (Martin Heidegger) ou, dans les termes du théologien Romano Guarini, « le langage qu’un homme parle est un monde dans lequel il vit et agit. » Cette langue du cœur se décline aussi en « musique du cœur » (heart music) : une musique qui nourrit notre enfance ou notre jeunesse et qui est plus à même de nous faire vibrer. Brian Schrag, un missionnaire de retour « au pays » raconte une expérience :
Quand je suis retourné à Dallas, Paul et Linda Neely m’ont amené dans leur église à Duncanville, TX. Après avoir été au loin à l’étranger pendant si longtemps, adorer Dieu dans mon propre langage et mes habitudes artistiques, signifiait beaucoup pour moi. Entendre des chants que je connaissais et qui m’étaient familiers, il n’en fallait pas plus pour que je me mette à pleurer. J’aimerais aider les gens à faire l’une de ces expériences pour être capable de se connecter à Dieu de la façon la plus profonde possible. (Blog-Worldofworship)
L’ethnodoxologie considère le récit de la Pentecôte, événement central de l’histoire du salut, comme un symbole fort de la liberté qu’a chaque peuple de célébrer les louanges de Dieu dans sa langue : « Chacun a entendu les choses merveilleuses que Dieu a accomplies dans sa langue maternelle. » (Ac 2.11). C’est bien la preuve qu’il ne pouvait être question d’enfermer l’Évangile dans une culture unique. On assiste à la naissance d’un christianisme qui œuvre pour la diversité linguistique, ou mieux encore, une universalité qui respecte l’identité spécifique de chaque individu.
La méthodologie que nous avons mise en place pour le projet Loka est celle présentée par l’équipe du GEN (Global Ethnodxology Network) et dont les étapes sont résumées ci-dessous :
- Découvrir les genres artistiques de la communauté
- Préciser les valeurs et les objectifs du Royaume de Dieu
- Identifier les genres artistiques (ou certains aspects) les plus appropriés pour communiquer les valeurs chrétiennes et les objectifs du Royaume de Dieu
- Approfondir la tradition artistique qui a été retenue
- Déclencher la créativité parmi les chrétiens au moyen d’activités diverses
- Évaluer les nouvelles compositions
- Célébrer et intégrer pour assurer la continuité de ce processus.
LES OBJECTIFS DU PROJET
Le projet LOKA a pris naissance pour :
C’est dans ce contexte qu’est née l’ethnodoxologie, une pratique qui cherche à valoriser la musique traditionnelle et autres arts locaux des peuples missionnés.
La méthodologie que nous avons mise en place est celle présentée par l’équipe du GEN (Global Ethnodxology Network) et dont les principes sont résumés ci-dessous :
- Découvrir les genres artistiques de la communauté
- Préciser les valeurs et les objectifs du Royaume de Dieu
- Identifier les genres artistiques (ou certains aspects) les plus appropriés pour communiquer les valeurs chrétiennes et les objectifs du Royaume de Dieu
- Approfondir la tradition artistique qui a été retenue
- Déclencher la créativité parmi les chrétiens au moyen d’activités diverses
- Évaluer les nouvelles compositions
- Célébrer et intégrer pour assurer la continuité de ce processus.
LES RENCONTRES
Deux types de rencontres sont organisées tout au long de l’année : les séminaires (Bik-a-pawol) et les ateliers de composition collective.

Les séminaires sont en visio-conférence et ouverts à tous. Ils sont organisés comme un bik-a-pawol, ce mode de communication de la tradition orale guadeloupéenne et qui s’apparente à une agora ou à une causerie-débats. Les séminaires sont un espace d’échanges qui permet à chacun de s’exprimer, de poser des questions, de débattre sur le Gwoka (chant, instruments et danse) et son utilisation dans la liturgie du cule évangélique. Les dates des séminaires sont annoncées sur notre blog et notre page FB.
Les ateliers de composition sont organisés sur la Basse-Terre comme sur la Grande-Terre à la demande des églises. Ils peuvent avoir lieu soit de façon régulière soit ponctuelle. Les textes (généralement en langue créole) qui sont proposés par les participants doivent répondre à des critères de qualité à la fois linguistique et musicale (voix et instruments), mais aussi à des critères de pertinence liturgique : la fonction du chant dans le déroulement du culte. À ces critères s’ajoutent la fidélité au texte biblique, et l’apport anthropologique. En conclusion, en composant, notre objectif est un enrichissement à la fois spirituel, esthétique et… culturel.
Pour connaître les dates des prochains séminaires ou les lieux des ateliers, contactez-nous.
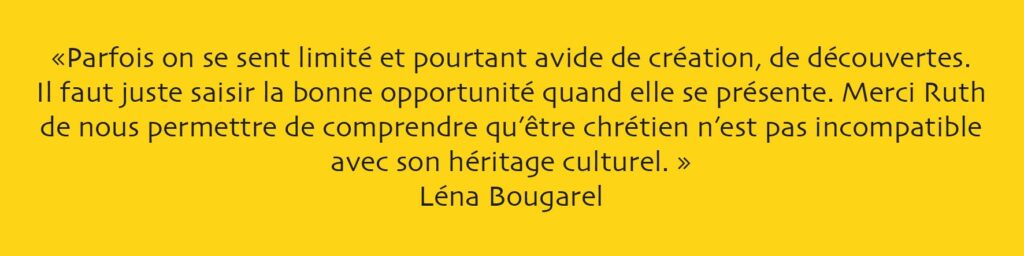
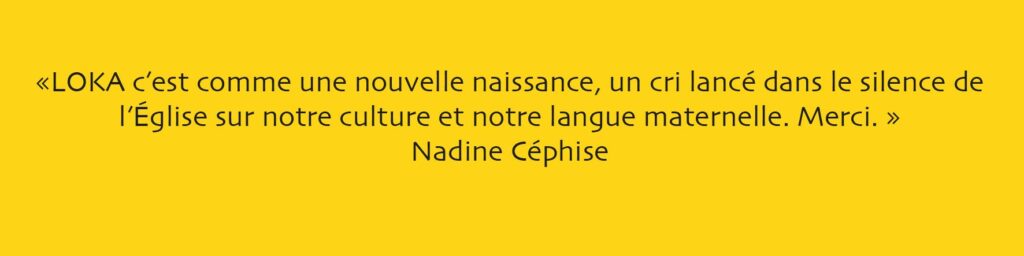
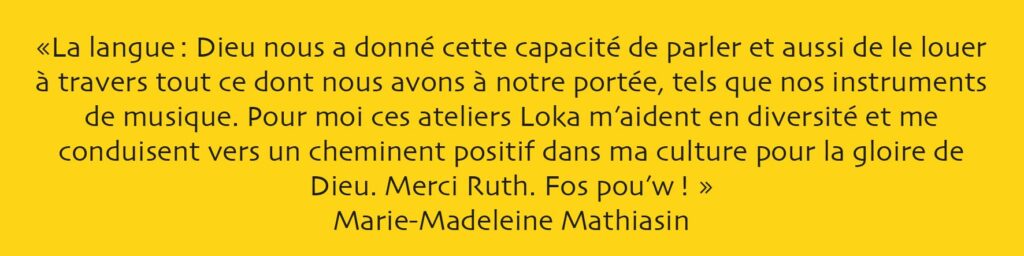
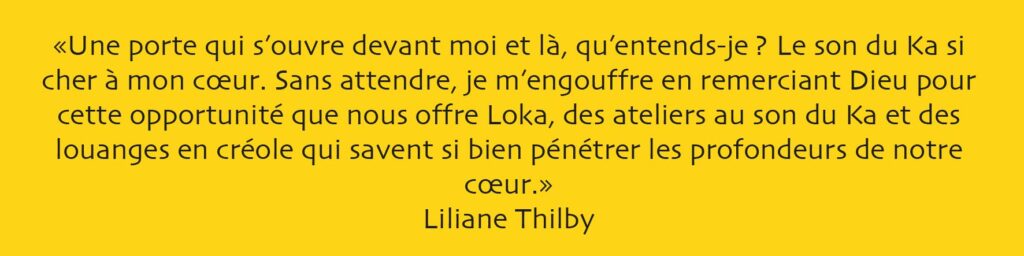
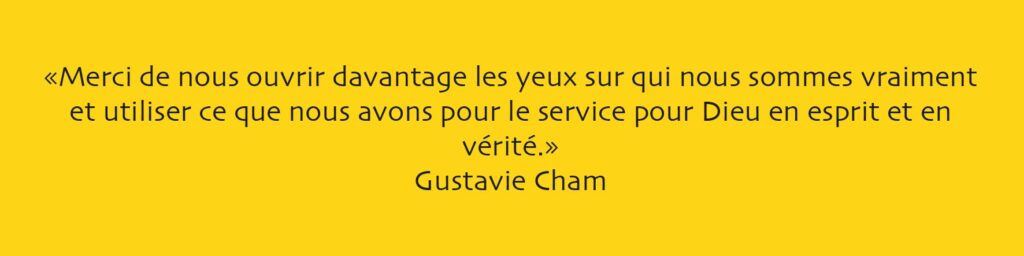
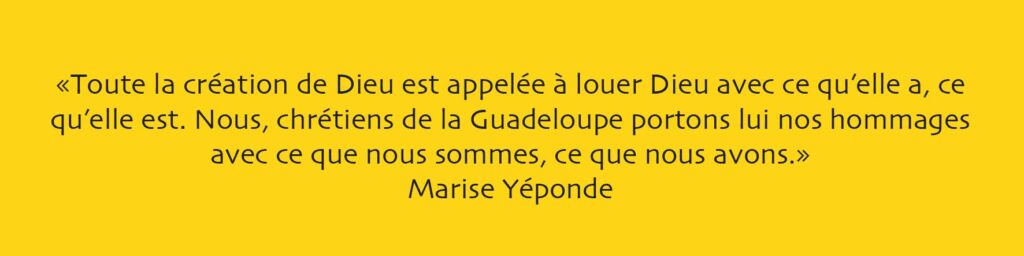
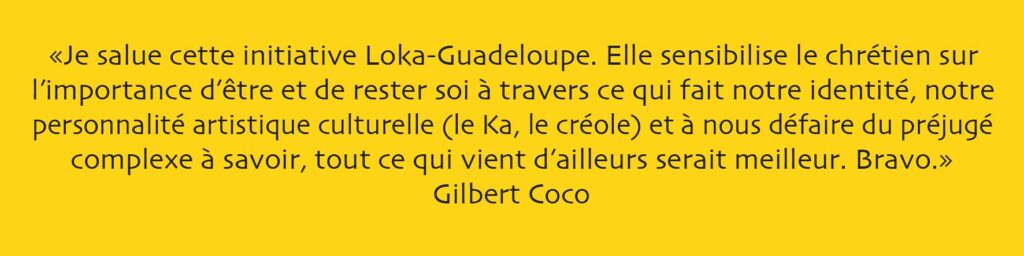
- Permettre une réflexion autour des traditions artistiques en Guadeloupe et de leur possibilité d’exprimer l’Évangile du salut et les valeurs évangéliques (justice, paix, réconciliation, pardon, amour-agape) ;
- Prendre en compte les expressions musicales traditionnelles du Guadeloupéen pour les évaluer, les intégrer, les transformer, pour créer une expression liturgique nouvelle à partir des racines multiples de l’identité guadeloupéenne ;
- Produire un recueil avec des textes en créole et en français dans l’expression artistique du Gwo-ka ;
- Permettre une réconciliation du Guadeloupéen avec le « Vié-Nèg » et le reste de la population, une acceptation fraternelle du Guadeloupéen dans sa pluralité (noirs, indiens, créoles, libanais et autres…).
